La Possibilité d'une île

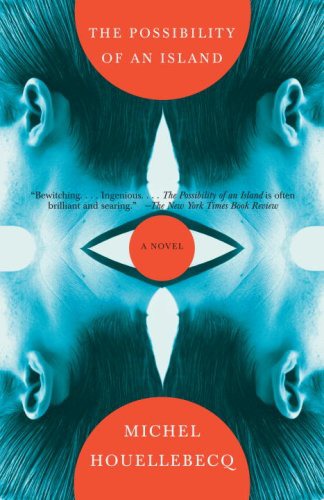 La possibilité d'une île
La possibilité d'une îleFayard
sans l'amitié et la grande gentillesse desquels
l'écriture de ce livre n'aurait pas été possible.
Ce livre doit sa naissance à Harriet Wolff, une journaliste allemande que j'ai rencontrée à Berlin il y a quelques années. Avant de me poser ses questions, Harriet a souhaité
me raconter une petite fable. Cette fable symbolisait, selon elle, la position d'écrivain qui est la mienne. Je suis dans une cabine téléphonique, après la fin du monde. Je peux passer autant de coups de téléphone que je veux, il n'y a aucune limite. On ignore si d'autres personnes ont survécu, ou si mes appels ne sont que le monologue d'un désaxé. Parfois l'appel est bref, comme si l'on m'avait raccroché au nez ; parfois il se prolonge, comme si l'on m'écoutait avec une curiosité coupable. Il n'y a ni jour; ni nuit ; la situation ne peut pas avoir de fin. Sois la bienvenue dans la vie éternelle, Harriet. Qui, parmi vous, mérite la vie éternelle ?
Mon incarnation actuelle se dégrade ; je ne pense pas qu'elle puisse tenir encore longtemps. Je sais que dans ma prochaine incarnation j e retrouverai mon compagnon, le petit chien Fox.
Le bienfait de la compagnie d'un chien tient à ce qu'il est possible de le rendre heureux ; il demande des choses si simples, son ego est si limité. Il est possible qu'à une époque antérieure les femmes se soient trouvées dans une situation comparable - proche de celle de l'animal domestique. Il y avait sans doute une forme de bonheur domotique lié au fonctionnement commun, que nous ne parvenons plus à comprendre ; il y avait sans doute le plaisir de constituer un organisme fonctionnel, adéquat, conçu pour accomplir une série discrète de tâches - et ces tâches, se répétant, constituaient la série discrète des jours. Tout cela a disparu, et la série des tâches ; nous n'avons plus vraiment d'objectif assignable ; les joies de l'être humain nous restent inconnaissables, ses malheurs à l'inverse ne peuvent nous découdre. Nos nuits ne vibrent plus de terreur ni d'extase ; nous vivons cependant, nous traversons la vie, sans joie et sans mystère, le temps nous paraît bref.
La première fois que j'ai rencontré Marie22, c'était sur un serveur espagnol bas de gamme ; les temps de connexion étaient effroyablement longs.
La fatigue occasionnée
Par le vieux Hollandais mort
N'est pas quelque chose qui s'atteste
Bien avant le retour du maître.
2711,325104,13375317,452626. À l'adresse indiquée j'eus la vision de sa chatte - saccadée, pixellisée, mais étrangement
réelle.
Était-elle une vivante, une morte ou une intermédiaire ? Plutôt une intermédiaire, je crois ; mais c'est une chose dont il était exclu de parler. Les femmes donnent une impression d'éternité, avec leur chatte branchée sur les mystères - comme s'il s'agissait d'un tunnel ouvrant sur l'essence du monde, alors qu'il ne s'agit que d'un trou à nains tombé en désuétude. Si elles peuvent donner cette impression, tant mieux pour elles ; ma parole est compatissante.
La grâce immobile,
Sensiblement écrasante
Qui découle du passage des civilisations
N'a pas la mort pour corollaire.
Il aurait fallu cesser. Cesser le jeu, l'intermédiation, le contact ; mais il était trop tard. 258, 129, 3727313, 11324410.
La première séquence était prise d'une hauteur. D'immenses bâches de plastique gris recouvraient la plaine ; nous étions au nord d'Almeria. La cueillette des fruits et des légumes qui poussaient sous les serres était naguère effectuée par des ouvriers agricoles - le plus souvent d'origine marocaine. Après l'automatisation, ils s'étaient évaporés dans les sierras environnantes. En plus des équipements habituels - centrale électrique alimentant la barrière de protection, relais satellite, capteurs - l'unité Proyecciones XXI, 13 disposait d'un générateur de sels minéraux, et de sa propre source d'eau potable. Elle était éloignée des grands axes, et ne figurait sur aucune carte récente - sa construction était postérieure aux derniers relevés. Depuis la suppression du trafic aérien et l'établissement d'un brouillage permanent sur les bandes de transmission satellite, elle était devenue virtuellement impossible à repérer.
La séquence suivante aurait pu être un rêve. Un homme qui avait mon visage mangeait un yaourt dans une usine sidérurgique ; le mode d'emploi des machinesoutils était rédigé en turc ; il était peu probable que la production vienne à redémarrer.
12,12, 533, 8467.
Le second message de Marie22 était ainsi libellé :
Je suis seule comme une conne
Avec mon
Con.
245535, 43, 3. Quand je dis « je », je mens. Posons le « je » de la perception - neutre et limpide. Mettonsle en rapport avec le « je » de l'intermédiation - en tant que tel, mon corps m'appartient ; ou, plus exactement, j'appartiens à mon corps. Qu'observons-nous ? Une absence de contact. Craignez ma parole.
Je ne souhaite pas vous tenir en dehors de ce livre ; vous êtes, vivants ou morts, des
lecteurs.
Cela se fait en dehors de moi ; et je souhaite que cela se fasse - ainsi, dans le silence.
Contrairement à l'idée requise,
La parole n'est pas créatrice d'un monde ;
L'homme parle comme le chien aboie
Pour exprimer sa colère, OH sa crainte.
Le plaisir est silencieux,
Tout comme l'est l'état de bonheur.
Le moi est la synthèse de nos échecs ; mais ce n'est qu'une synthèse partielle. Craignez ma parole. Ce livre est destiné à l'édification des Futurs. Les hommes, se diront-ils, ont pu produire cela. Ce n'est pas rien ; ce n'est pas tout ; nous avons affaire à une production intermédiaire.
Marie22, si elle existe, est une femme dans la même mesure où je suis un homme ; dans une mesure limitée, réfutable.
J'approche, moi aussi, de la fin de mon parcours. Nul ne sera contemporain de la naissance de l'Esprit, si ce n'est les Futurs ; mais les Futurs ne sont pas des êtres, au sens où nous l'entendons. Craignez ma parole.
Or, que fait un rat en éveil ? Il renifle. »
Jean-Didier - biologiste
Comme ils restent présents à ma mémoire, les premiers instants de ma vocation de bouffon ! J'avais alors dix-sept ans, et je passais un mois d'août plutôt morne dans un club
all inclusive
en Turquie - c'est d'ailleurs la dernière fois que je devais partir en vacances avec mes parents. Ma corme de sœur-elle avait treize ans à l'époque commençait à allumer tous les mecs. C'était au petit déjeuner ; comme chaque matin une queue s'était formée pour les œufs brouillés, dont les estivants semblaient particulièrement friands. À côté de moi, une vieille Anglaise (sèche, méchante, du genre à dépecer des renards pour décorer son living-room), qui s'était déjà largement servie d'œufs, rafla sans hésiter les trois dernières saucisses garnissant le plat de métal. Il était onze heures moins cinq, c'était la fin du service du petit déjeuner, il paraissait impensable que le serveur apporte de nouvelles saucisses. L'Allemand qui faisait la queue derrière elle se figea sur place ; sa fourchette déjà tendue vers une saucisse s'immobilisa à mi-hauteur, le rouge de l'indignation emplit son visage. C'était un Allemand énorme, un colosse, plus de deux mètres, au moins cent cinquante kilos. J'ai cru un instant qu'il allait planter sa fourchette dans les yeux de l'octogénaire, ou la serrer par le cou et lui écraser la tête sur le distributeur de plats chauds. Elle, comme si de rien n'était, avec cet égoïsme sénile, devenu inconscient, des vieillards, revenait en trottinant vers sa table. L'Allemand prit sur lui, je sentis qu'il prenait énormément sur lui, mais son visage recouvra peu à peu son calme et il repartit tristement, sans saucisses, en direction de ses congénères. À partir de cet incident, je composai un petit sketch relatant une révolte sanglante dans un club de vacances, déclenchée par des détails minimes contredisant la formule
all inclusive ;
une pénurie de saucisses au petit déjeuner, suivie d'un supplément à payer pour le minigolf. Le soir même je présentai ce sketch lors de la soirée
« Vous avez du talent ! » (un soir par semaine le spectacle était composé de numéros proposés par les vacanciers, à la place des animateurs professionnels) ; j'interprétais tous les personnages à la fois, débutant ainsi dans la voie du
one man show
dont je ne devais pratiquement plus sortir, tout au long de ma carrière. Presque tout le monde venait au spectacle d'après-dîner, il n'y avait pas grandchose à foutre jusqu'à l'ouverture de la discothèque ; cela faisait déjà un public de huit cents personnes. Ma prestation obtint un succès très vif, beaucoup riaient aux larmes et il y eut des applaudissements nourris. Le soir même, à la discothèque, une jolie brune appelée Sylvie me dit que je l'avais beaucoup fait rire, et qu'elle appréciait les garçons qui avaient le sens de l'humour. Chère Sylvie. C'est ainsi que je perdis ma virginité, et que se décida ma vocation.
Après mon baccalauréat, je m'inscrivis à un cours d'acteurs ; s'ensuivirent des années peu glorieuses pendant lesquelles j e devins de plus en plus méchant, et par conséquent de plus en plus caustique ; le succès, dans ces conditions, finit par arriver - d'une ampleur, même, qui me surprit. J'avais commencé par des petits sketches sur les familles recomposées, les j ournalistes du
Monde,
la médiocrité des classes moyennes en général -je réussissais très bien les tentations incestueuses des intellectuels en milieu de carrière face à leurs filles ou belles-filles, le nombril à
l'air et le string dépassant du pantalon. En résumé, j'étais un
observateur acéré de la réalité contemporaine
; on me comparait souvent à Pierre Desproges. Tout en continuant à me consacrer au
one man show,
j'acceptai parfois des invitations dans des émissions de télévision que je choisissais pour leur forte audience et leur médiocrité
générale. Je ne manquais jamais de souligner cette médiocrité, subtilement toutefois : il fallait que le présentateur se sente un peu en danger, mais pas trop. En somme, j'étais un
bonprofessionnel
; j'étais juste un peu surfait. Je n'étais pas le seul.
Je ne veux pas dire que mes sketches n'étaient pas drôles ; drôles, ils l'étaient. J'étais, en effet, un observateur acéré de la réalité contemporaine ; il me semblait simplement que c'était si élémentaire, qu'il restait si peu de choses à observer dans la réalité contemporaine : nous avions tant simplifié, tant élagué, tant brisé de barrières, de tabous, d'espérances erronées, d'aspirations fausses ; il restait si peu, vraiment. Sur le plan social il y avait les riches, il y avait les pauvres, avec quelques fragiles passerelles - l'
ascenseur social,
sujet sur lequel il était convenu d'ironiser ; la possibilité plus sérieuse de se ruiner. Sur le plan sexuel il y avait ceux qui inspiraient le désir, et ceux qui n'en inspiraient aucun : mécanisme exigu, avec quelques complications de modalité (l'homosexualité, etc.), quand même aisément résumable à la vanité et à
la compétition narcissique, déjà bien décrites par les moralistes français trois siècles auparavant. Il y avait bien sûr par ailleurs les
braves gens,
ceux qui travaillent, qui opèrent la production effective des denrées, ceux aussi qui - de manière quelque peu comique, ou pathétique si l'on veut (mais j'étais, avant tout, un comique) se sacrifient pour leurs enfants ; ceux qui n'ont ni beauté
dans leur jeunesse, ni ambition plus tard, ni richesse jamais ; qui adhèrent cependant de tout cœur - et même les premiers, avec plus de sincérité que quiconque - aux valeurs de la beauté, de la jeunesse, de la richesse, de l'ambition et du sexe ; ceux qui forment, en quelque sorte, le
liant de la sauce.
Ceux-là ne pouvaient, j'ai le regret de le dire, pas constituer un
sujet.
J'en introduisais quelquesuns dans mes sketches pour donner de la diversité, de
l'effet de réel
; je commençais quand même sérieusement à me lasser. Le pire est que j'étais considéré comme un
humaniste ;
un humaniste
grinçant,
certes, mais un humaniste. Voici, pour situer, une des plaisanteries qui émaillaient mes spectacles :
« Tu sais comment on appelle le gras qu'y a autour du vagin ?
-Non.
- La femme. »
Chose étrange, j'arrivais à placer ce genre de trucs sans cesser d'avoir de bonnes critiques dans
Elle
et dans
Télérama
; il est vrai que l'arrivée des comiques beurs avait revalidé les dérapages machistes, et que je dérapais concrètement avec grâce : lâchage de carres, reprise, tout dans le contrôle. Finalement, le plus grand bénéfice du métier d'humoriste, et plus généralement de l'
attitude
humoristique
dans la vie, c'est de pouvoir se comporter comme un salaud en toute impunité, et même de pouvoir grassement rentabiliser son abjection, en succès sexuels comme en numéraire, le tout avec l'approbation générale. Mon humanisme supposé reposait en réalité sur des bases bien minces : une vague saillie sur les buralistes, une allusion aux cadavres des clandestins nègres rejetés sur les côtes espagnoles avaient suffi à me valoir une réputation d'
homme de gauche
et de
défenseur des droits
de l'homme.
Homme de gauche, moi ? J'avais occasionnellement pu introduire dans mes sketches quelques altermondialistes, vaguement jeunes, sans leur donner de rôle immédiatement antipathique ; j'avais occasionnellement pu céder à une certaine démagogie : j'étais, je le répète, un bon professionnel. Par ailleurs j'avais une tête d'Arabe, ce qui facilite ; le seul contenu résiduel de la gauche en ces années c'était Pantiracisme, ou plus exactement le racisme antiblancs. Je ne comprenais d'ailleurs pas très bien d'où me venait ce faciès d'Arabe, de plus en plus caractéristique au fil des années : ma mère était d'origine espagnole et mon père, à ma connaissance, breton. Ma sœur par exemple, la petite pétasse, avait indiscutablement le type méditerranéen, mais elle n'était pas moitié aussi basanée que moi, et ses cheveux étaient lisses. On aurait pu s'interroger : ma mère s'étaitelle montrée d'une fidélité scrupuleuse ? Ou avais-je pour géniteur un Mustapha quelconque ? Ou même autre hypothèse - un Juif ?
Fuck with that :
les Arabes venaient à mes spectacles, massivement - les Juifs aussi d'ailleurs, quoique un peu moins ; et tous ces gens payaient leur ticket, plein tarif. On se sent concerné